


© Voyages en Art Déco 2020

Art Déco parisien

Art Déco et mouvement moderne
A - Historique
B - L’Habitat social
C - Les édifices publics et religieux
A - Historique
A - Historique
1 - Les origines du renouveau de l’architecture à Paris
Vers 1910 un courant artistique souffle sur Paris en réaction aux excès de l’Art Nouveau.
A
la
liberté
existant
depuis
1882
(assouplissement
des
normes
haussmanniennes)
de
nouvelles
idées
sur l’urbanisme et l’architecture venant de plusieurs pays d’Europe arrivent en France.
A cela s’ajoutent les premières tentatives d’utilisation du béton armé dans les immeubles d’habitation.
Plusieurs
bâtiments
témoignent
de
ces
audaces
comme
le
théâtre
des
Champs-Elysées,
A.
Perret
1913,
le 25 bis rue Franklin A. Perret 1904, l’immeuble de la rue Vavin H. Sauvage 1906.


2 - Les années 20 : Naissance de l’Art Déco
Après
la
guerre
14/18
on
rejette
totalement
l’Art
Nouveau
et
un
désir
très
fort
de
créativité
et
d’inventivité
parcourt
les
milieux
artistiques
et
l’architecture.
Ces
idées
trouvent
leur
source
dans
le
17
e
et
18
e
siècle
français,
symboles
du
classicisme
national,
mais
aussi
dans
l’influence
du
cubisme
et
d’un
certain exotisme.
La
rose,
symbole
du
nouvel
art
de
vivre
à
la
française.
En
1919
André
Mare
crée
la
Compagnie
des
arts
français,
dont
l’objectif
est
de
proposer
un
style
français
moderne
basé
sur
la
tradition
et
la
raison.
La
rose
seule,
ou
en
corbeille,
mais
aussi
les
fruits
deviendront
le
thème
préféré
des
ornements
des
immeubles jusqu’au début des années 30.
Ces
thèmes
géométrisés
ou
en
spirales
orneront
les
bâtiments
en
fresques
ou
en
fer
forgé
sur
les
garde-corps et les entrées.
Déjà
influencées
par
les
transatlantiques
les
façades
verront
fleurir
des
fenêtres
hublots
ovales
ou octogonales.
Les
baies
passeront
de
deux
vantaux
à
4
ou
6
afin
d’élargir le champ de vision.
Les
cages
d’escaliers
seront
éclairés
par
la
lumière
naturelle.
Les
angles
des
bâtiments
seront
cassés
ou
arrondis.
Les bow-windows géométriques égaieront les façades et augmenteront les surfaces des logements.
L’ornementation
de
façade
sera
réduite
à
quelques
bas-reliefs
ou
des
mosaïques.
Les
immeubles
seront souvent coiffés de frontons.
Les ordres antiques seront présents mais simplifiés ou géométrisés.
Les
garde-corps
et
portes
d’entrées
seront
en
fer
forgé
décorés
de
dessins
géométriques
ou
floraux
(roses et fruits stylisés).

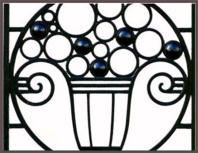




3 - 1925 l’exposition fondatrice
Prévue
en
1916
mais
reportée
en
1925
à
cause
de
la
guerre
l’exposition
internationale
des
arts
décoratifs
et
industriels
modernes
va
devenir
l’événement
phare
du
renouveau
de
l’architecture
et
des
arts appliqués.
Même
si
on
ne
peut
parler
de
style
1925,
comme
il
y
a
le
style
louis
XV
ou
renaissance,
on
peut
retenir
le
terme
d’esprit
1925
qui
deviendra
plus
tard
«Art
déco»
(ce
terme
a
pris
naissance
dans
les
années
70
en
référence
au
courant
traditionaliste
présent
dans
les
propositions
des
pavillons
français adeptes d’un néo classicisme).
Dans
cette
exposition
qui
présente
de
nombreux
pavillons
nationaux
et
étrangers,
deux
conceptions
s’affrontent
dans
le
camp français :
Un
mouvement
traditionaliste
qui
tout
en
rejetant
les
excès
de
«l’Art
nouveau»
est
avide
de
modernité
et
veut
proposer
un
art
décoratif
à
la
française
puisant
dans
le
siècle
classique
(17
e
) un vocabulaire architectural renouvelé.
Les
ordres,
tels
:
colonnes,
frises,
bas
reliefs,
seront
donc
classiques
mais
stylisés,
avec
des
dessins
géométriques
influencés par le cubisme.
L’ornementation
ne
va
pas
disparaître
mais
sera
plus
discrète
mettant
en
valeur
corbeilles
de
roses
et
de
fruits,
dessins
spirales et géométriques.
Ce
mouvement
que
l’on
appelait
à
l’époque
«moderniste»
ou
«contemporain»
tentera
de
faire
la
synthèse
de
la
simplicité
moderne
et
de
la
raison classique.
Les
principaux
architectes
qui
suivront
cette
tendance
seront
Roux
Spitz,
Patout,
Plumet
Tauzin Huillard, Thiers, Boileau, Bonnier…
Un
autre
mouvement
qui
constitue
l’avant-garde
architecturale
et
se
veut
international,
tentera
de
se
faire
entendre
notamment
avec
les
pavillons
de
«L’esprit
nouveau»
de
Le
Corbusier
et
celui
du
tourisme
avec
le
fameux
campanile
de
Mallet-
Stevens.
Ce
mouvement
inspiré
par
les
théories
de
Stijl
hollandais
et
du
Bauhaus
allemand
propose
une
révolution
dans
l’art
d’habiter
avec
la
suppression
totale
de
l’ornementation,
l’emploi
du
béton
armé,
la
standardisation
et
l’industrialisation
des
matériaux,
la
cubisation
des
volumes,
l’élargissement
des
fenêtres.
Dans
son
manifeste
(vers
une
architecture)
publié
avec
le
peintre
Ozenfant,
Le
Corbusier
chef
de
file
du
mouvement
propose
une
liste
de
5
points
essentiels
dans
la
construction
moderne :
- Le toit terrasse
- Le plan libre
- La fenêtre bandeau
- La paroi libre
- Les pilotis
Les
autres
noms
attachés
à
ce
courant
seront
ceux
de,
Pierre
Chareau,
Eileen
Gray,
Francis
Jourdain,
Robert
Mallet-Stevens,
Lurçat,
Pingusson, Tony Garnier.
Auguste
Perret
pourtant
pionnier
avec
ses
immeubles
béton
d’avant-garde
défendra
un
style
classique
adapté aux nouveau matériaux.
A
l’expo
de
1925
il
présentera
un
théâtre
éphémère
en
bois
destiné
à
montrer
l’importance
des
ossatures dans un bâtiment.
Compromis
provisoire,
le
pavillon
«une
ambassade
française»
réunira
les
grands
noms
de
société
des
artistes modernes et classiques tels que Groult, Chareau, Dunand, Mallet-Stevens.
4 - Création de L’UAM (union des artistes modernes)
En
1929,
emmenée
par
Robert
Mallet
Stevens,
la
branche
la
plus
avant-gardiste
de
La
Société
des
artistes
décorateurs
se
sépare
pour
fonder
l’UAM
union
des
artistes
modernes
;
objectif
:
obtenir
plus
de
reconnaissance
pour
les
créateurs,
adeptes
d’un
renouveau
profond
en
matière
d’architecture
et
d’art appliqués.
En
dehors
du
chef
de
file,
on
trouve
Jean
Prouve,
Charlotte
Perriand,
Pierre
Chareau,
les
frères
Martel,
Pierre Legrain, Francis Jourdain, Sonia Delaunay, René Herbst… parmi les plus célèbres.
Le
mot
d’ordre
de
ce
courant
qui
réunit
des
architectes
mais
aussi
des
peintres,
des
sculpteurs,
des
maître-
verriers,
des
créateurs
de
bijoux,
de
textiles…
est
de
partir
de
la
fonction
et
de
s’appuyer
sur
les
nouveaux
matériaux
les
nouvelles
formes,
les
nouvelles
techniques pour leurs œuvres.
La
plupart
des
créateurs
de
l’UAM
flirtent
avec
l’Art
Déco mais l’inverse est également vrai.
La
vraie
frontière
se
situe
dans
l’utilisation
des
matériaux plus ou moins nobles et l’ornementation.
L’UAM
mise
à
mal
par
la
guerre
de
39/45
continuera
tout de même jusqu’en 1958.
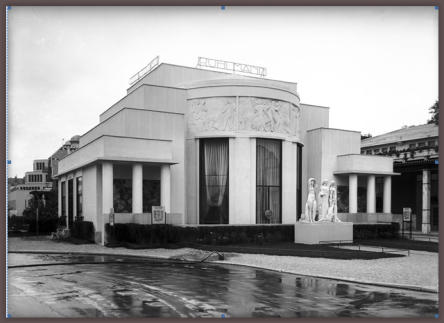
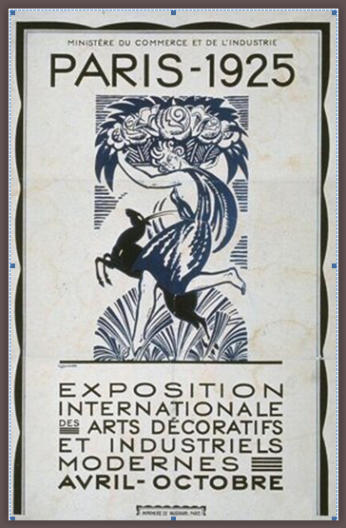
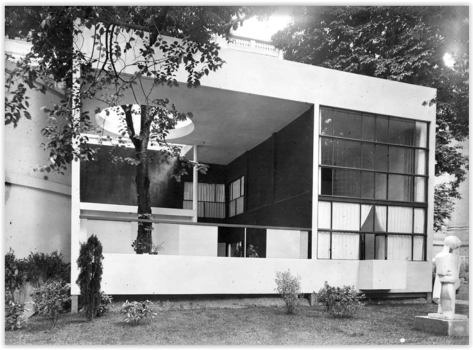









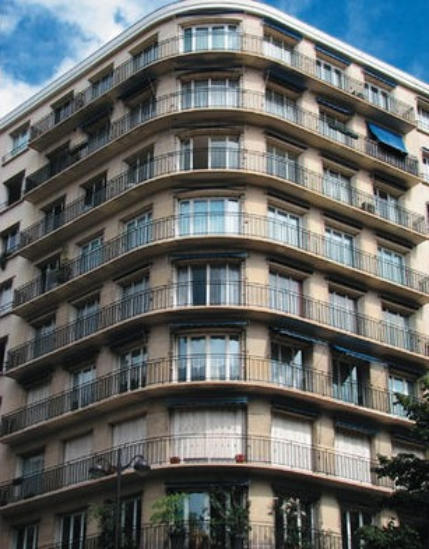


6 - L’exposition universelle de 1937
Nommée
officiellement
«exposition
des
arts
et
techniques
appliquées
a
la
vie
moderne»
réunissant
50
nations,
elle
devait
unir
les
états
et
les
peuples
mais
vit
plutôt
un
affrontement
des
puissances
européennes
notamment
l’Allemagne
nazie
et
l’URSS
communiste
avec
une
architecture
pompeuse
et
de style néo-classique.
Survivent à l’emplacement initial :
•
Le Palais de Chaillot et Palais de la Découverte
•
Le Palais de Tokyo et le MAM Paris
•
Le musée de travaux publics devenu conseil économique, social environnemental
•
Les fontaines de la Porte de St-Cloud
D’une
façon
générale
la
résistance
à
l’architecture
moderne
qui
existait
déjà
dans
l’expo
de
1925
persista en 1937.
Mallet-Stevens
se
vit
toutefois
confier
5
pavillons
dont
le
spectaculaire
pavillon
de
l’électricité
et
de
la
lumière.
Le Corbusier ne put que proposer un musée sous tente pour promouvoir ses idées sur l’urbanisation.
L’expo de 1937 brilla des derniers feux de l’architecture de l’entre deux guerres.
Deux ans plus tard la France fut envahie pour 5 ans.
7 - L’architecture d’après guerre : les années 50
Paris
ayant
été
peu
touchée
par
les
destructions,
l’architecture
des
années
50
se
concentrera
principalement dans les quartiers et îlots insalubres (tels les 13
e
, 14
e
, 15
e
, 19
e
et 20
e
arrondissements).
Même
si
un
certain
néo-classicisme
perdurera
dans
les
programmes
destinés
à
une
clientèle
aisée,
ce
sont les idées de la mouvance avant-gardiste qui domineront avec le meilleur et le pire.
B -
L’habitat
social
B - L’habitat social
1 - La ceinture rose
En 1919, vote du déclassement de l’enceinte de Thiers bâtie en 1840.
Cette
décision
libère
quantités
de
terrains
et
de
friches
autour
de
Paris
qui
serviront
à
héberger
de
nouvelles populations venues grossir les effectifs parisiens.
Au total plus de 50 000 logements sociaux HBM seront réalisés de 1921 à 1939.
2 - Les années 20
De
1923
à
1927,
13
ensembles
sont
réalisés
par
l’agence
d’architecture
de
Paris
HBM
(Habitations
à
Bon Marché).

Fenêtres
à
4
vantaux
pour
faire
pénétrer
la
lumière,
mélange
de
brique
et
de
béton
pour
briser
l’uniformité
des
façades,
mosaïques
sur
le
fronton
d’inspiration
flamande,
balustrades
en
fer
forgé.
Quel
raffinement
pour
ces
logements
sociaux.



La vision d’Henri sauvage
Déjà
engagé
dans
le
logement
social
avant
la
guerre
de
14/18,
et
ayant
déjà
expérimenté
rue
Vavin
une
construction
pilote
(1912)
Henri
Sauvage
met
en
œuvre
ses
théories
d’une
cité
à
gradins
avec
piscine dans l’ensemble de 78 logements rue des Amiraux à Paris 18
e
.
La façade à carreaux de porcelaine blanche assure à la fois hygiène et pureté.
3 - Les années 30
L’agence
d’architecture
de
la
ville
de
Paris
HBM
trouve
son
âge
d’or
de
1929
à
1937
en
proposant
pour
les
classes
modestes
mais
aussi
moyennes,
des
logements
confortables
bien
équipés,
dont
le
style
trouve un juste équilibre entre le mouvement moderne et le néo-classicisme.
Mélange
subtil
de
la
brique
et
du
béton,
créativité
dans
les
façades
par
la
variation
des
bow-windows,
balcons
fréquents,
ateliers
d’artistes
aux
derniers
étages,
toits-terrasses,
fenêtres
à
plusieurs
vantaux
(3 et 4 souvent), colonnes d’escaliers vitrées.





5 - Les années 30
La
crise
économique
américaine
de
1929
ne
touchera
la
France
qu’en
1931
mais
impactera
sérieusement l’architecture parisienne.
En
dehors
du
palais
de
la
Porte
Dorée
monumental
vaisseau
à
la
gloire
de
la
France
Coloniale
(expo
de
1931)
les
constructions
dans
les
années
30
chercheront
à
être
plus
simples
plus
économiques
et
réservées
soit
aux
bâtiments
publiques
(écoles,
églises,
administrations,
casernes…)
soit
aux
édifices
commerciaux
(grands
magasins,
hôtels,
boutiques.)
Les
bâtiments
d’habitation
seront
plutôt
destinés
à
une
population
aisée
(immeubles
de
standing,
hôtels particuliers, ateliers d’artistes…) ou au logement social (les fameux HBM).
Le style des années 30 évoluera vers :
- La montée en puissance de l’utilisation du béton armé
- La suppression des ornementations «art déco»
- La généralisation des bow-windows avec un élargissement des surfaces vitrées
- L’influence des navires transatlantiques avec le style paquebot ou streamline moderne.



C - Les édifices publics religieux et commerciaux
1 - Les écoles
Les
années
30
sont
marquées
par
une
vague
de
constructions
d’écoles
;
24
seront
construites
de
1930 à 1939.
Les
bâtiments
passeront
de
l’école
au
«groupe
scolaire»
;
Ce
changement
est
concrétisé
par
l’apparition
de
grands
ensembles
de
béton
et
de
briques
à
l’architecture
moderne
et
dépouillée
qui
deviendront des monuments de quartiers.



2 - Les églises
Lancé
en
1931
par
le
cardinal
Verdier
Archevêque
de
Paris,
un
grand
programme
de
constructions
et
de
rénovations
d’églises,
destiné
à
couvrir
les
besoins
des
nouvelles
populations,
va
permettre
l’éclosion de nouveaux édifices religieux dans la capitale.
Les principales églises seront :
•
Saint-Jean Bosco
•
Du Saint-Esprit
•
Saint-Michel des Batignolles
•
Saint-Léon
•
Sainte-Odile
•
Saint-Christophe de Javel, par exemple, est située à côté des usines Citroën gros employeur du 15
e
.
Le style des ces églises sera soit néo-byzantin soit néo-gothique.
Les
matériaux
peu
coûteux,
comme
le
béton
et
la
brique,
les
emboîtements
des
volumes
seront
en
relation avec le courant moderne.



3 - Les piscines et bains publics
Après
la
première
guerre
mondiale,
l’hygiène,
le
sport,
la
vie
en
plein
air,
prennent
de
plus
en
plus
d’importance.
La
première
vraie
piscine
sera
à
Paris,
celle
de
la
Butte
aux
Cailles
(1921)
encore
très
influencée
par
l’Art
Nouveau,
puis
la
piscine
des
Tourelles
qui
servira
aux
jeux
olympiques
de
1924
(toujours
en
activité
mais
profondément
restaurée)
enfin
les
Amiraux
(1926)
et
Molitor
(1929)
par
Pollet
(qui
construira aussi la piscine de la rue de Pontoise et celle de la rue Pailleron).
Une
douzaine
de
bain-douches
publics
seront
également
créés
dans
les
années
20
et
30
pour
contribuer à amener plus d’hygiène et de propreté.




4 - Les grands bâtiments publics, les grands magasins, les cinémas et théâtres
En
passant
du
muet
au
parlant,
le
cinéma
va
considérablement
augmenter
son
public,
on
verra
des
salles comme le Gaumont Palace place de Clichy, aujourd’hui disparu, proposer plus de 5000 places.


Les
grands
magasins
existaient
depuis
le
siècle
dernier
mais
leurs
extensions
seront
réalisées
dans
un
style
Art
Déco
(Samaritaine, galeries Lafayette…)


Les
bâtiments
administratifs,
ministères,
postes,
quelques
mairies
adopteront
aussi
l’architecture
à
la
mode
Art
Déco
puis
la
mouvance
plus
moderne
le
«streamline»
et
rarement le style international.




C



Art Déco parisien

A - Historique
A - Historique
1 - Les origines du renouveau de l’architecture
à Paris
Vers
1910
un
courant
artistique
souffle
sur
Paris
en
réaction aux excès de l’Art Nouveau.
A
la
liberté
existant
depuis
1882
(assouplissement
des
normes
haussmanniennes)
de
nouvelles
idées
sur
l’urbanisme
et
l’architecture
venant
de
plusieurs pays d’Europe arrivent en France.
A
cela
s’ajoutent
les
premières
tentatives
d’utilisation
du
béton
armé
dans
les
immeubles
d’habitation.
Plusieurs
bâtiments
témoignent
de
ces
audaces
comme
le
théâtre
des
Champs-Elysées,
A.
Perret
1913,
le
25
bis
rue
Franklin
A.
Perret
1904,
l’immeuble de la rue Vavin H. Sauvage 1906.


2 - Les années 20 : Naissance de l’Art Déco
Après
la
guerre
14/18
on
rejette
totalement
l’Art
Nouveau
et
un
désir
très
fort
de
créativité
et
d’inventivité
parcourt
les
milieux
artistiques
et
l’architecture.
Ces
idées
trouvent
leur
source
dans
le
17
e
et
18
e
siècle
français,
symboles
du
classicisme
national,
mais
aussi
dans
l’influence
du
cubisme
et
d’un
certain exotisme.
La
rose,
symbole
du
nouvel
art
de
vivre
à
la
française.
En
1919
André
Mare
crée
la
Compagnie
des
arts
français,
dont
l’objectif
est
de
proposer
un
style
français moderne basé sur la tradition et la raison.
La
rose
seule,
ou
en
corbeille,
mais
aussi
les
fruits
deviendront
le
thème
préféré
des
ornements
des
immeubles jusqu’au début des années 30.
Ces
thèmes
géométrisés
ou
en
spirales
orneront
les
bâtiments
en
fresques
ou
en
fer
forgé
sur
les
garde-corps et les entrées.
Déjà
influencées
par
les
transatlantiques
les
façades
verront
fleurir
des
fenêtres
hublots
ovales
ou octogonales.
Les
baies
passeront
de
deux
vantaux
à
4
ou
6
afin
d’élargir le champ de vision.
Les
cages
d’escaliers
seront
éclairés
par
la
lumière
naturelle.
Les
angles
des
bâtiments
seront
cassés
ou
arrondis.
Les
bow-windows
géométriques
égaieront
les
façades
et
augmenteront
les
surfaces
des
logements.
L’ornementation
de
façade
sera
réduite
à
quelques
bas-reliefs
ou
des
mosaïques.
Les
immeubles
seront souvent coiffés de frontons.
Les
ordres
antiques
seront
présents
mais
simplifiés
ou géométrisés.
Les
garde-corps
et
portes
d’entrées
seront
en
fer
forgé
décorés
de
dessins
géométriques
ou
floraux
(roses et fruits stylisés).


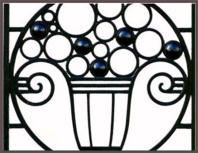



3 - 1925 l’exposition fondatrice
Prévue
en
1916
mais
reportée
en
1925
à
cause
de
la
guerre
l’exposition
internationale
des
arts
décoratifs
et
industriels
modernes
va
devenir
l’événement
phare
du
renouveau
de
l’architecture
et des arts appliqués.
Même
si
on
ne
peut
parler
de
style
1925,
comme
il
y
a
le
style
louis
XV
ou
renaissance,
on
peut
retenir
le
terme
d’esprit
1925
qui
deviendra
plus
tard
«Art
Déco»
(ce
terme
a
pris
naissance
dans
les
années
70
en
référence
au
courant
traditionaliste
présent
dans
les
propositions
des
pavillons
français
adeptes d’un néo classicisme).
Dans
cette
exposition
qui
présente
de
nombreux
pavillons
nationaux
et
étrangers,
deux
conceptions
s’affrontent dans le camp français :
Un
mouvement
traditionaliste
qui
tout
en
rejetant
les
excès
de
«l’Art
nouveau»
est
avide
de
modernité
et
veut
proposer
un
Art
Décoratif
à
la
française
puisant
dans
le
siècle
classique
(17
e
)
un
vocabulaire architectural renouvelé.
Les
ordres,
tels
:
colonnes,
frises,
bas
reliefs,
seront
donc
classiques
mais
stylisés,
avec
des
dessins
géométriques influencés par le cubisme.
L’ornementation
ne
va
pas
disparaître
mais
sera
plus
discrète
mettant
en
valeur
corbeilles
de
roses
et de fruits, dessins spirales et géométriques.
Ce
mouvement
que
l’on
appelait
à
l’époque
«moderniste»
ou
«contemporain»
tentera
de
faire
la
synthèse
de
la
simplicité
moderne
et
de
la
raison
classique.
Les
principaux
architectes
qui
suivront
cette
tendance
seront
Roux
Spitz,
Patout,
Plumet
Tauzin
Huillard, Thiers, Boileau, Bonnier…
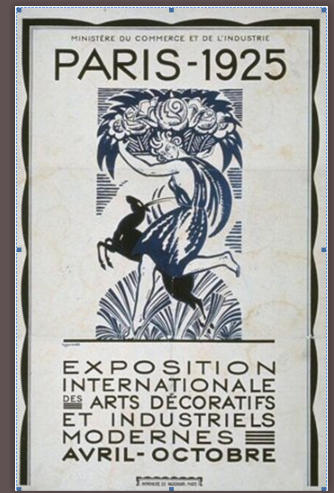
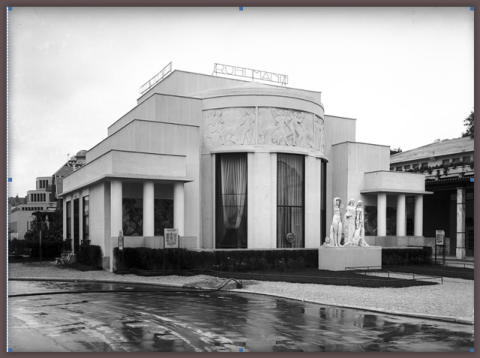
Un
autre
mouvement
qui
constitue
l’avant-garde
architecturale
et
se
veut
international,
tentera
de
se
faire
entendre
notamment
avec
les
pavillons
de
«L’esprit
nouveau»
de
Le
Corbusier
et
celui
du
tourisme
avec
le
fameux
campanile
de
Mallet-
Stevens.
Ce
mouvement
inspiré
par
les
théories
de
Stijl
hollandais
et
du
Bauhaus
allemand
propose
une
révolution
dans
l’art
d’habiter
avec
la
suppression
totale
de
l’ornementation,
l’emploi
du
béton
armé,
la
standardisation
et
l’industrialisation
des
matériaux,
la
cubisation
des
volumes,
l’élargissement des fenêtres.
Dans
son
manifeste
(vers
une
architecture)
publié
avec
le
peintre
Ozenfant,
Le
Corbusier
chef
de
file
du
mouvement
propose
une
liste
de
5
points
essentiels dans la construction moderne :
- Le toit terrasse
- Le plan libre
- La fenêtre bandeau
- La paroi libre
- Les pilotis
Les
autres
noms
attachés
à
ce
courant
seront
ceux
de,
Pierre
Chareau,
Eileen
Gray,
Francis
Jourdain,
Robert
Mallet-Stevens,
Lurçat,
Pingusson,
Tony
Garnier.
Auguste
Perret
pourtant
pionnier
avec
ses
immeubles
béton
d’avant-garde
défendra
un
style
classique adapté aux nouveau matériaux.
A
l’expo
de
1925
il
présentera
un
théâtre
éphémère
en
bois
destiné
à
montrer
l’importance
des
ossatures dans un bâtiment.
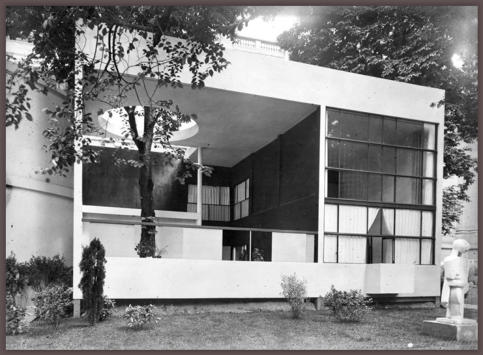
Compromis
provisoire,
le
pavillon
«une
ambassade
française»
réunira
les
grands
noms
de
société
des
artistes
modernes
et
classiques
tels
que Groult, Chareau, Dunand, Mallet-Stevens.
4
-
Création
de
L’UAM
(union
des
artistes
modernes)
En
1929,
emmenée
par
Robert
Mallet
Stevens,
la
branche
la
plus
avant-gardiste
de
La
Société
des
artistes
décorateurs
se
sépare
pour
fonder
l’UAM
union
des
artistes
modernes
;
objectif
:
obtenir
plus
de
reconnaissance
pour
les
créateurs,
adeptes
d’un
renouveau
profond
en
matière
d’architecture et d’art appliqués.
En
dehors
du
chef
de
file,
on
trouve
Jean
Prouve,
Charlotte
Perriand,
Pierre
Chareau,
les
frères
Martel,
Pierre
Legrain,
Francis
Jourdain,
Sonia
Delaunay, René Herbst… parmi les plus célèbres.
Le
mot
d’ordre
de
ce
courant
qui
réunit
des
architectes
mais
aussi
des
peintres,
des
sculpteurs,
des
maître-verriers,
des
créateurs
de
bijoux,
de
textiles…
est
de
partir
de
la
fonction
et
de
s’appuyer
sur
les
nouveaux
matériaux
les
nouvelles
formes,
les
nouvelles
techniques
pour
leurs œuvres.
La
plupart
des
créateurs
de
l’UAM
flirtent
avec
l’Art
Déco mais l’inverse est également vrai.
La
vraie
frontière
se
situe
dans
l’utilisation
des
matériaux
plus
ou
moins
nobles
et
l’ornementation.
L’UAM
mise
à
mal
par
la
guerre
de
39/45
continuera tout de même jusqu’en 1958.

5 - Les années 30
La
crise
économique
américaine
de
1929
ne
touchera
la
France
qu’en
1931
mais
impactera
sérieusement l’architecture parisienne.
En
dehors
du
palais
de
la
Porte
Dorée
monumental
vaisseau
à
la
gloire
de
la
France
Coloniale
(expo
de
1931)
les
constructions
dans
les
années
30
chercheront
à
être
plus
simples
plus
économiques
et
réservées
soit
aux
bâtiments
publiques
(écoles,
églises,
administrations,
casernes…)
soit
aux
édifices
commerciaux
(grands
magasins,
hôtels,
boutiques.)
Les
bâtiments
d’habitation
seront
plutôt
destinés
à
une
population
aisée
(immeubles
de
standing,
hôtels
particuliers,
ateliers
d’artistes…)
ou
au
logement social (les fameux HBM).
Le style des années 30 évoluera vers :
-
La
montée
en
puissance
de
l’utilisation
du
béton
armé
- La suppression des ornementations «Art Déco»
- La généralisation des bow-windows avec un
élargissement des surfaces vitrées
-
L’influence
des
navires
transatlantiques
avec
le
style paquebot ou streamline moderne.




6 - L’exposition universelle de 1937
Nommée
officiellement
«exposition
des
arts
et
techniques
appliquées
à
la
vie
moderne»
réunissant
50
nations,
elle
devait
unir
les
états
et
les
peuples
mais
vit
plutôt
un
affrontement
des
puissances
européennes
notamment
l’Allemagne
nazie
et
l’URSS
communiste
avec
une
architecture
pompeuse et de style néo-classique.
Survivent à l’emplacement initial :
•
Le Palais de Chaillot et Palais de la Découverte
•
Le Palais de Tokyo et le MAM Paris
•
Le
musée
de
travaux
publics
devenu
conseil
économique, social environnemental
•
Les fontaines de la Porte de St-Cloud




D’une
façon
générale
la
résistance
à
l’architecture
moderne
qui
existait
déjà
dans
l’expo
de
1925
persista en 1937.
Mallet-Stevens
se
vit
toutefois
confier
5
pavillons
dont
le
spectaculaire
pavillon
de
l’électricité
et
de
la
lumière.
Le
Corbusier
ne
put
que
proposer
un
musée
sous
tente pour promouvoir ses idées sur l’urbanisation.
L’expo
de
1937
brilla
des
derniers
feux
de
l’architecture de l’entre deux guerres.
Deux
ans
plus
tard
la
France
fut
envahie
pour
5
ans.
7 -
L’architecture d’après guerre :
les années 50
Paris
ayant
été
peu
touchée
par
les
destructions,
l’architecture
des
années
50
se
concentrera
principalement
dans
les
quartiers
et
îlots
insalubres
(tels
les
13
e
,
14
e
,
15
e
,
19
e
et
20
e
arrondissements).
Même
si
un
certain
néo-classicisme
perdurera
dans
les
programmes
destinés
à
une
clientèle
aisée,
ce
sont
les
idées
de
la
mouvance
avant-
gardiste qui domineront avec le meilleur et le pire.



B -
L’habitat
social
B - L’habitat social
1 - La ceinture rose
En
1919,
vote
du
déclassement
de
l’enceinte
de
Thiers bâtie en 1840.
Cette
décision
libère
quantités
de
terrains
et
de
friches
autour
de
Paris
qui
serviront
à
héberger
de
nouvelles
populations
venues
grossir
les
effectifs
parisiens.
Au
total
plus
de
50
000
logements
sociaux
HBM
seront réalisés de 1921 à 1939.
2 - Les années 20
De
1923
à
1927,
13
ensembles
sont
réalisés
par
l’agence
d’architecture
de
Paris
HBM
(Habitations
à
Bon Marché).
Fenêtres
à
4
vantaux
pour
faire
pénétrer
la
lumière,
mélange
de
brique
et
de
béton
pour
briser
l’uniformité
des
façades,
mosaïques
sur
le
fronton
d’inspiration
flamande,
balustrades
en
fer
forgé.
Quel
raffinement
pour
ces
logements
sociaux.


La vision d’Henri sauvage
Déjà
engagé
dans
le
logement
social
avant
la
guerre
de
14/18,
et
ayant
déjà
expérimenté
rue
Vavin
une
construction
pilote
(1912)
Henri
Sauvage
met
en
œuvre
ses
théories
d’une
cité
à
gradins
avec
piscine
dans
l’ensemble
de
78
logements
rue
des Amiraux à Paris 18
e
.
La
façade
à
carreaux
de
porcelaine
blanche
assure
à la fois hygiène et pureté.



3 - Les années 30
L’agence
d’architecture
de
la
ville
de
Paris
HBM
trouve
son
âge
d’or
de
1929
à
1937
en
proposant
pour
les
classes
modestes
mais
aussi
moyennes,
des
logements
confortables
bien
équipés,
dont
le
style
trouve
un
juste
équilibre
entre
le
mouvement
moderne et le néo-classicisme.
Mélange
subtil
de
la
brique
et
du
béton,
créativité
dans
les
façades
par
la
variation
des
bow-windows,
balcons
fréquents,
ateliers
d’artistes
aux
derniers
étages,
toits-terrasses,
fenêtres
à
plusieurs
vantaux
(3 et 4 souvent), colonnes d’escaliers vitrées.







C - Les édifices publics religieux et
commerciaux
C - Les édifices publics religieux et
commerciaux
1 - Les écoles
Les
années
30
sont
marquées
par
une
vague
de
constructions
d’écoles
;
24
seront
construites
de
1930 à 1939.
Les
bâtiments
passeront
de
l’école
au
«groupe
scolaire»
;
Ce
changement
est
concrétisé
par
l’apparition
de
grands
ensembles
de
béton
et
de
briques
à
l’architecture
moderne
et
dépouillée
qui
deviendront des monuments de quartiers.



2 - Les églises
Lancé
en
1931
par
le
cardinal
Verdier
Archevêque
de
Paris,
un
grand
programme
de
constructions
et
de
rénovations
d’églises,
destiné
à
couvrir
les
besoins
des
nouvelles
populations,
va
permettre
l’éclosion
de
nouveaux
édifices
religieux
dans
la
capitale.
Les principales églises seront :
•
Saint-Jean Bosco
•
Du Saint-Esprit
•
Saint-Michel des Batignolles
•
Saint-Léon
•
Sainte-Odile
•
Saint-Christophe de Javel, par exemple, est
située à côté des usines Citroën gros employeur
du 15
e
.
Le
style
des
ces
églises
sera
soit
néo-byzantin
soit
néo-gothique.
Les
matériaux
peu
coûteux,
comme
le
béton
et
la
brique,
les
emboîtements
des
volumes
seront
en
relation avec le courant moderne.



3 - Les piscines et bains publics
Après
la
première
guerre
mondiale,
l’hygiène,
le
sport,
la
vie
en
plein
air,
prennent
de
plus
en
plus
d’importance.
La
première
vraie
piscine
sera
à
Paris,
celle
de
la
Butte
aux
Cailles
(1921)
encore
très
influencée
par
l’Art
Nouveau,
puis
la
piscine
des
Tourelles
qui
servira
aux
jeux
olympiques
de
1924
(toujours
en
activité
mais
profondément
restaurée)
enfin
les
Amiraux
(1926)
et
Molitor
(1929)
par
Pollet
(qui
construira
aussi
la
piscine
de
la
rue
de
Pontoise
et
celle de la rue Pailleron).
Une
douzaine
de
bain-douches
publics
seront
également
créés
dans
les
années
20
et
30
pour
contribuer à amener plus d’hygiène et de propreté.




4
-
Les
grands
bâtiments
publics,
les
grands magasins, les cinémas et théâtres
En
passant
du
muet
au
parlant,
le
cinéma
va
considérablement
augmenter
son
public,
on
verra
des
salles
comme
le
Gaumont
Palace
place
de
Clichy,
aujourd’hui
disparu,
proposer
plus
de
5000
places.

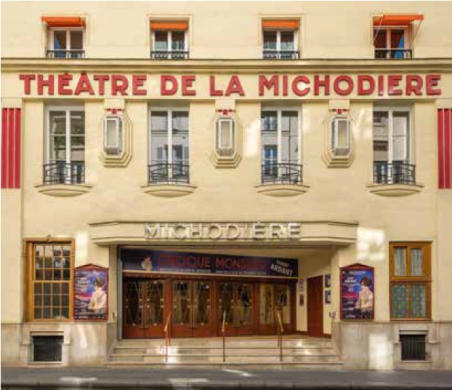
Les
grands
magasins
existaient
depuis
le
siècle
dernier
mais
leurs
extensions
seront
réalisées
dans
un style Art Déco (Samaritaine, galeries Lafayette…)


Les
bâtiments
administratifs,
ministères,
postes,
quelques
mairies
adopteront
aussi
l’architecture
à
la
mode
Art
Déco
puis
la
mouvance
plus
moderne
le «streamline» et rarement le style international.



Art Déco et mouvement moderne
A - Historique
B - L’Habitat social
C - Les édifices publics et religieux

© Voyages en Art Déco 2020































